USA 2000

La merveilleuse Nissan Altima que nous
avons fini par louer … chez Budget |
No driver license …
Cette année, nos vacances commencent très
fort : on a oublié notre permis de conduire à Nice. Une étourderie
qui sera la source de rocambolesques “aventures”.
Où l’on verra que les Américains
ne sont pas tous riches. Que les Asiatiques ne sont pas tous souriants,
ni les Blacks tous en prison. Mais que la
Californie est bien une mosaïque ethnique
(32% d’Hispaniques, 12% d’Asiatiques, 7% de Noirs).
Où l’on comprendra à quel point
le précepte “It’s the Law” régit la société.
Et que la Police est moins à cheval avec la Loi … que certaines
entreprises privées.
Où l'on apprendra à nos dépens
que le Consulat de France ne s'intéresse qu'aux Français
… morts (lire aussi le témoignage de Philippe,
un Français de Californie)
Pour finir, nous serons “sauvés” par le
Rêve Américain, en la personne d’Oliver David Gomes, un Hispano-Black-Américain
qui mérite d’être élu “President of the USA” ! |
Lundi 11 septembre
Tout avait pourtant bien commencé. Temps
parfait au départ de Nice, à 14 heures. Un atterrissage en
douceur à SFO, l’aéroport de San Francisco - le pilote Swissair
recevant les applaudissements des passagers - après douze heures
d’un vol sans turbulences.
 La seule tempête est “dans nos crânes””, peu de temps avant
l’arrivée, quand M. s’aperçoit soudain … qu’il a oublié
son permis de conduire à Nice : il le revoit parfaitement, bien
caché dans une boite à chaussure, en compagnie du chéquier,
elle-même planquée dans l’armoire : on n’est jamais trop prudent
avec les cambrioleurs …
La seule tempête est “dans nos crânes””, peu de temps avant
l’arrivée, quand M. s’aperçoit soudain … qu’il a oublié
son permis de conduire à Nice : il le revoit parfaitement, bien
caché dans une boite à chaussure, en compagnie du chéquier,
elle-même planquée dans l’armoire : on n’est jamais trop prudent
avec les cambrioleurs …
- “On est foutu !” soupire-il
Moi, toujours optimiste : “mais non, on va bien
trouver un moyen. Et ce sera l’occasion de juger de la souplesse (ou de
la rigidité ?) des Américains”.
Mon optimisme en prend un premier coup lors du
passage à la douane : nous choisissons la mauvaise file, celle
qui nous fera sortir, bons derniers, de l’aéroport après
une heure d’attente debout, vacillant de sommeil devant la guérite
des douaniers.
Enfin, le coup de tampon ramolli de l’imposante
fonctionnaire Black de service.
S’iI est 20 heures ici, pour nous, c’est 5 heures
du mat’ après une nuit blanche. Pas les conditions idéales
pour affronter Hertz.
Encore 20 minutes de queue … avant le coup de
grâce : “in California, no driver license, no car”.
Si j’avais été dans mon état
normal, j’aurais pu lui répliquer : “non, c’est pas vrai ! En France,
par contre, on roule sans permis !”
Comme ce n’est pas le cas, nous regardons sans
broncher l’employée en jaune appeler sa supérieure, une Black
sévère aux cheveux gris. Dans son regard impitoyable,
nous lisons : “IT’S THE LAW”.
Elle nous tend malgré tout une perche (pour
nous aider ou nous enfoncer ?) : “allez donc voir le DMV (department for
Motor Vehicules) qui délivre des permis provisoires”.
Un tuyau crevé, comme on le verra par la
suite.
Pour l’heure, nous sommes désemparés,
incapables de réagir. Sans voiture, comment rejoindre notre
motel 6 de Fremont, à plus de 50 kilomètres de l’aéroport
(le taxi doit être exorbitant) ?
Humour du désespoir, quand je lance “this
night, we will sleep under the bridges !”, l’employée, elle, s’attendrit.
Qu’on attende la fin de son service, à 23 heures, et elle nous accompagnera
à notre hôtel.
Il est 21 heures mais, au point où on en
est … après 12 heures d’avion, 9 heures de décalage horaire,
une heure à la douane.
Assis sur la banquette en skaï devant le
comptoir Hertz, effondrés et hagards, impossible de réfléchir
froidement. Sinon, on aurait peut-être essayé les autres loueurs
: ils ne peuvent pas être tous aussi implacables avec la Loi
?
Malheureusement, dans les brumes de la fatigue
et du stress, nous cherchons désespérément une idée
(mais pas celle-là, bien sûr).
Téléphoner au consulat de France
: c’est leur job d’aider les Français dans la m… à l’étranger,
non ?
Je me lève pour examiner les téléphones
: ils sont comme dans les films, à pièces (de 35 cents).
Eh oui, ça se passe comme ça, au pays qui a inventé
la “credit card” : leçon numéro 1 !
On fait comment quand on n’a pas de monnaie ?
Quant aux annuaires, c’est comme chez nous : ils se battent en duel, à
moitié déchirés et ne concernent que … la banlieue
sud de San Francisco.
Leçon numéro 2 : dans l’aéroport
international de San Francisco, impossible de trouver un annuaire de la
ville.
A qui demander de l’aide ? Au guichet Avis (chez
Hertz, je n’ose plus !), on me renvoie à un agent qui m’indique
“the white phone” : un téléphone “de courtoisie”, blanc en
effet, gratuit, pour dépanner les paumés comme nous. Nous
finissons par obtenir le numéro du consulat - plus tard, reposée,
je m’apercevrais que je l’avais, ce numéro, noté dans mon
carnet - mais tombons sur un répondeur. Forcément,
à cette heure tardive.
M. laisse un message, du style SOS.
De nouveau assis dans un courant d’air glacial
en attendant notre “sauveur”, le temps ne passe pas. Le nombre de clients
diminue peu à peu. Bons derniers à attendre encore, nous
faisons pitié à un souriant Asiatique de chez Hertz, à
qui nous répétons “no driver license, forgotten, forgotten
“ … Lueur d’espoir, il part téléphoner … mais revient penaud
(ça ne répond pas). Il nous explique : “certains acceptent
de louer sans permis, d’autres pas”. C’est du moins ce que je crois comprendre
mais sans en tirer la conclusion qui s’impose : aller voir les concurrents
!
Non, trop éreintés, moralement à
plat, nous ne réagissons plus. Croyant nous remonter le moral, il
nous apporte une brochure détaillée sur San Francisco : on
se voit déjà en train d’errer durant deux semaines dans cette
ville. Ce qui, aussi belle soit-elle, ne serait pas des vacances à
notre goût.
C’est au moment où, le moral au plus bas,
je fond en larmes, que notre “ange gardien” nous fait signe de la suivre.
Une petite femme blonde au visage fripé mais souriant, voila la
bouée de secours à laquelle nous nous accrochons jusqu’à
sa voiture …
Sa voiture : une vieille Américaine qui
pue la clope froide. Mais elle s’en excuse, ainsi que de la saleté
: visiblement, elle mange dedans, et depuis longtemps, si l’on en croit
les strates de reliefs de repas sur le sol et les sièges.
Le coffre (“broken”) n’ouvrant plus, nous entassons
nos valises sur les sièges qui, débarrassés de leurs
cochonneries, sont littéralement noirs, et de plus, gluants.
Pourtant, c’est avec entrain et reconnaissance
qu’on s’installe, les pieds dans les courants d’air (le chauffage également
est “broken”) et le nez dans les vapeurs de clopes refroidies (moi qui
ne supporte pas la fumée). Moment délicieux !
Durant les 50 kilomètres de route, Sharen
aura le temps de nous raconter sa vie : originaire de Seattle, plaquée
par un mari qui buvait, vivant à l’hôtel … Trois ans de galère
et de “struggle for life”. Heureuse aujourd’hui d’avoir ce job chez Hertz,
qui lui permet de payer ses factures, elle vit seule avec ses “five birds”
: je la fais répéter. Oui, avec ses 5 oiseaux … et
l’aide de Dieu. Elle ne veut plus entendre parler des hommes. Mais elle
reste sensible aux malheurs d’autrui : des gens l’ont aidé quand
elle était dans la merde, aujourd’hui, elle essaie de rendre à
son tour.
Elle aura fait un détour de 100 kilomètres,
après une journée de travail, pour deux inconnus, étrangers
de surcroît. Merci Sharen, “you are a nice person”, nous ne t’oublierons
jamais.
Leçon numéro 3 : les Américains
ne sont pas tous riches. Et certains sont même très “humains”.
Au motel, la galère n’est pas terminée
: certes, la chambre a bien été réservée. Mais
au moment d’introduire la clé dans la serrure de notre chambre
212, nous voyant déjà sous la douche, la porte résiste
… et on entend une voix à l’intérieur : la chambre est occupée
!
Stupeur, effondrement, la loi des séries
s’est bel et bien enclenchée.
Retour à l’accueil où la difforme
employée du Motel 6 se met au téléphone, sans nous
jeter un regard. On attend, incertains. Durant 5 minutes, 10 minutes …
Rien ne vient. Quand enfin, elle daigne s’intéresser à nous,
c’est pour nous faire dire, par la bouche d’un énorme Black au crâne
rasé, qu’il y a eu erreur : quelqu’un s’est trompé de chambre,
nous avons bien la 212. Plus que 15 minutes (une broutille), le temps qu’on
fasse le ménage. Debout à côté de nos valises,
regardant arriver les voitures “louches” (tout nous parait louche, ce soir),
à bout de force, j’en attrape un fou rire nerveux.
Enfin, la chambre, la douche, le lit. Un motel
6 vieillot, une chambre “non smoking” qui sent la fumée refroidie.
Mais ce n’est pas le moment de faire la fine bouche. Il est minuit, soit
9 heures du mat’ pour nous. Plus que temps de dormir.
Mercredi 13
Trop épuisés nerveusement pour bien
dormir, nous sommes réveillés dès 7 heures.
Mentalement, je calcule qu’il est déjà
16 heures en France, les bureaux vont bientôt fermer. Vite, appeler
le consulat de France pour qu’ils contactent la préfecture de Nice.
Déjà sur les dents, M. laisse un
deuxième message au répondeur puis, rappelle dès 8
heures pour tomber, enfin, sur un permanent du Consulat. Ouf, quelqu’un
qui va nous aider.
Illusions perdues : le “vice-consul”, accent très
Neuilly-Auteuil-Passy, le prend de haut : “le consulat ne s’occupe
que des cas graves, comme le rapatriement sanitaire des corps”.
Désolé, je ne suis pas mort, mais
peut-être pourriez-vous contacter la préfecture de Nice …
Très suffisant, il s’enquiert : “avez-vous la possibilité
de vous faire envoyer votre permis de France ?”
Non, si on l’avait, on te t’appelerait pas, très
cher.
Et le vice-consul de nous achever : “repassez
donc votre permis de conduire en Californie, c’est très facile”
!
Avec l’espoir de tomber sur un employé
plus avenant, M. s’obstine à rappeler un peu plus tard le Consulat.
Pour tomber sur une petite fonctionnaire, déjà aigrie de
bon matin, au ton excédée, répétant en boucle
: “il n’y a pas de solution … Il faudra vous le dire combien de fois”.
Leçon numéro 4 : le Consulat de
France ne s’intéresse qu’aux Français morts ou quasiment
morts. Ne pas espérer le moindre mot d’encouragement de leur part,
ce n’est pas dans leurs attributions.
Bon, restons calmes. Et si on essayait ce fameux
DMV ?
Après un petit déjeuner chez de
sympathiques Vietnamiens-Américains dans les parages de l’hôtel,
nous appelons un taxi, conduit par un Indonésien-Américain,
pour s’entendre dire, par une Chino-Américaine, qu’elle ne délivre
pas du tout de permis provisoire. Seule possibilité : repasser le
permis … Ceci dit sans un sourire, d’un air pincé et méprisant.
Je la fusille du regard, pour lui prouver que
je la méprise encore plus … Petit soulagement bien temporaire.
Que faire ? Je suggère : ne nous
laissons pas abattre, passons, comme prévu à l’origine, la
journée à San Francisco, en empruntant le BART. Nous demandons
le chemin de la gare à un Taiwanais-Américain, souriant,
lui. Renonçant à nous expliquer, il se propose de nous y
conduire. Dans une superbe Lincoln dernier modèle aux sièges
en cuir tendre. Un moment de douceur dans ce monde si “hard”.
Leçon numéro 5 : en Amérique,
acheter un ticket de train est un vrai chemin de croix.
Il y a bien un guichet mais il faut avoir l’appoint
… Et ce n’est pas une blague !
Quant aux distributeurs automatiques, ils nécessitent
un mode d’emploi. Après dix minutes de vaine prise de tête,
la grosse Africaine-Américaine derrière son guichet nous
prend en pitié et se lève pour venir nous expliquer la procédure
: trouver une machine qui marche (une sur deux est en panne), mettre une
pièce de monnaie d’abord (au pif), appuyer sur un bouton pour fait
défiler des chiffres, cent par cent, jusqu’à la somme voulue.
Enfin, enfoncer un autre bouton pour obtenir le ticket. Ce qui suppose
qu’on connait le montant exact de son billet, montant qui est affiché,
en petit, sur un autre panneau … Quand on sait, c’est facile.
Enfin dans le BART, nous comprenons pourquoi les
Américains ne prennent pas le train. C’est un genre de RER ringard
des années 70, bien moins moderne qu’un métro parisien d’il
y a 20 ans, bruyant et bringuebalant, puant la pisse (vécu !) et
emprunté en majorité par les émigrants pauvres d’origine
asiatique - c‘est à dire sans voiture.
Trois quart d’heure plus tard, nous descendons
dans le Financial District, l’Amérique des buildings et des business
men (and women) pressés.
De là, nous partons, à pied of course,
pour ce fameux “Pier Thirty Nine” (Quai 39), dont Sharen nous a parlé
en termes dithyrambiques.
 |
En marchant le long de la Baie de San Francisco,
le moral revient. Pensons au moment présent. Admirons, de loin,
les célèbres “painted ladies”, maisons recouvertes de décors
en bois de séquoia peint dans les tons pastel, les cable-cars et
les joggers, les rues de pente et, enfin, Fisherman’s Wharf, le Pier 39,
“l’attraction numéro Un de San Francisco”.
Mais là, déception : ce “quai
des Pêcheurs” n’est qu’un énorme centre commercial-attrape-touristes
doté d’attractions à la Disney, genre aquarium géant,
autos tamponneuses, Carousel vénitien, jeux vidéos … Seul
reliquat d’authenticité : le sol en bois. Dommage qu’il soit refait
à neuf ! |
Plus loin, le Pier 41 est le quai des ferries pour
Alcatraz. Il faut y faire la queue une heure afin d’obtenir un ticket …
pour un départ le lendemain. Vous avez dit touristique ?
Très peu pour nous. Reprenons le chemin
du BART en traversant China Town, parait-il le “quartier chinois
le plus ancien et le plus grand des USA, comptant 200.000 asiatiques”.
A pied, il nous parait pas si gigantesque, peuplé certes d’Asiatiques
mais sans rien de particulier si ce n’est les nombreuses boutiques débordant
de fruits et légumes exotiques.
De retour dans Union Square et ses buildings,
après un dernier coup d’oeil à la gracieuse Transamerica
Pyramid au sommet tronqué, nous reprenons notre BART puant. A Fremont,
il faut encore prendre un bus pour rejoindre notre hôtel. Pourquoi
pas le 21, il va dans la bonne direction. Manque de chance, nous descendons
beaucoup trop tôt. Encore une petite demie-heure de marche, trois
fois rien. Sauf que j’irai pieds nus pour les décongestionner. Au
diable le quand dira-t’on !
Enfin le motel 6 et la douche pendant des heures.
Pour dîner, nous retournons dans le “Donuts” (fast-food de beignets
au sucre et croissants au jambon) de nos amis Vietnamiens, qui apprécient
les Français : nos médecins ont une bonne réputation,
aux dires de leurs compatriotes exilés en France.
Dans notre chambre, M. a une nouvelle idée
: appeler le numéro d’urgence inscrit sur notre carte de crédit
Gold. Bien sûr … mais. Téléphoner, facile à
dire.
D’abord, car le numéro s’avère …
périmé.
Heureusement, nous avons la carte France Telecom.
Pour appeler la France depuis l’étranger, rien de plus simple :
il suffit de composer …un numéro à 12 chiffres, puis le 1,
puis un numéro à 9 chiffres, puis notre code à 4 chiffres,
puis le numéro qu’on souhaite appeler et la touche étoile.
Bienvenue dans la vie facile !
Enfin muni du bon numéro, M. tombe sur une
interlocutrice aimable (merveilleux !), qui va s’occuper de contacter la
préfecture de Nice. L’espoir renaît, nous nous endormons un
peu rassurés.
Réveillés en sursaut par le téléphone
à minuit (certes, en France, il est 9 heures du matin), c’est
pour s’entendre dire qu’il n’y a rien à faire, la préfecture
ne donne aucun renseignements concernant les permis de conduire. Secret
d’état ?
Après ça, difficile de bien dormir.
Dès 5 heures 30, nous sommes sur le pied de guerre, moi avec un
bon mal de crâne. Tout va bien, chantons sous la douche.
A 7 heures, nous décidons qu’il nous faut
un vrai breakfast : essayons de retrouver le Restaurant Denny’s entre-aperçu
en arrivant en voiture avec Sharen.
Et nous voila partis, pour franchir, à
pied, le pont de l’autoroute.
Quinze minutes de marche plus tard, nous mesurons
enfin notre petitesse, notre insignifiance. Le Denny’s n’existe pas, du
moins pour un piéton. Sans doute est-il quelque part, tout au bout
de l’horizon. Inaccessible sans voiture.
Marcher, c’est possible, il y a bien un trottoir
agréable, de plus bordé d’herbes, sur le bord de la route.
Mais il reste désespérément vide. Durant ces deux
jours de marche forcée sur les trottoirs de l’Amérique, nous
ne croiserons jamais personne … Sauf, rencontre surréaliste ce matin-là,
un vieil Hindou à turban, qui nous saluera d’un Hello bien américain.
Leçon numéro 6 : aux USA, on ne
marche pas … car les distances sont trop grandes, tout simplement.
Ayant compris la leçon, nous retournons
sagement déjeuner chez nos gentils Vietnamiens, qui essaient de
nous remonter le moral. Mais ils ont l’air sceptiques quand nous leur soumettons
l’idée du jour : aller voir la police de Fremont.
C’est mon idée : s’adresser directement
aux flics pour savoir si c’est vraiment grave de rouler sans permis. Auquel
cas on abandonnera.
En route pour le centre-ville : prendre un bus,
puis demander son chemin. Partir dans la mauvaise direction, revenir dans
l’autre sens, marcher, marcher, marcher sur ces magnifiques trottoirs déserts.
Sous un soleil de plus en plus chaud. Arriver enfin en vue du commissariat,
sur le Stevenson Boulevard … une énorme bâtisse carrée
à plusieurs étages, flambant neuve qui nous parait disproportionnée
pour un petite ville. Mais on dirait que les riches du coin investissent
pour leur sécurité.
Regrettant de ne pas avoir l’appareil photo -
personne ne voudra croire en France qu’il s’agit d’un simple poste de police
et non du Palais d’un Prince mégalomane - nous franchissons, un
poil intimidés, le gigantesque hall tout en marbre et chromes.
A l’accueil, une jeune femme avenante. Comme nous
lui expliquons nos misères, je la vois s’attendrir, nous regardant
avec un brin de pitié.
Quand je lui demande si on risque la prison à
conduire sans permis, elle me rassure : “si nous sommes arrêtés
par la police, il nous suffirait de leur envoyer plus tard par fax une
copie de notre permis”.
En résumé : à nous de négocier
avec les loueurs de voiture. Sur notre demande, elle consent même
à nous rédiger un petit mot d’explication.
Leçon numéro 7 : rouler
sans permis aux Etats-Unis, c’est possible !
Forts de cette constatation, nous repartons d’un
bon pied, avec le projet de négocier avec le comptoir Hertz repéré
à la gare de Fremont. Là, un Mexico-Américain bodybuildé
écoute notre laïus. Mais il doit encore demander l’autorisation.
Et la réponse est NON.
Mais … si même la police dit que ce n’est
pas un problème …
- “La police, c’est la police, Hertz, c’est Hertz”,
lâche-t’il, le front buté. Soudain, il est devenu glacial
et méprisant. Pour un peu, il nous dénoncerait aux flics
… s’ils n’étaient pas de notre côté !
Finalement, sa bêtise, qui prête à
rire, nous remonte le moral : ça ne doit pas être difficile
de trouver quelqu’un de plus ouvert que ça …
Leçon numéro 8 : certaines entreprises
privées sont plus à cheval avec la Loi que la Police.
Retournons au motel pour téléphoner,
je propose, et faisons le tour des autres loueurs.
Et voila comment, après avoir encore essuyé
les refus d’Avis et de National, enfin, Budget nous sauvera la mise :
“I HAVE A CAR FOR YOU”, sonne comme une douce
mélodie à nos oreilles.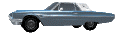
Certes, c’est un loueur situé à
Hayward, c’est à dire à perpette. Et de reprendre le bus,
le BART, puis un taxi. Folklorique, le chauffeur de taxi Pakistano-Américain,
trifouillant dans le moteur d’une vieille Chevy noire de crasse. Mais enfin,
nous arrivons à bon port, reçu par Oliver David Gomes, un
Blacko-Mexico-Américain et avant tout un Être Humain.
Patron d’une petite agence à l’ambiance
décontractée, il nous réchauffe le coeur avec son
efficacité au service du client. Certes, il n’a plus de voiture
à nous proposer. Mais il fera une demie-heure de route pour nous
accompagner, dans sa Lincoln personnelle, chez son collègue de Pleasanton,
où nous pourrons enfin prendre possession d’une (tant désirée)
Nissan Altima.
En chemin, nous aurons le temps d’apprécier
ses qualités de manager à l’américaine : une énergie
à revendre, dingue de boulot (aujourd’hui, c’est en fait son jour
de congé !), une vision positiviste (le client comme ses employés
doivent y trouver leur intérêt) et des projets grandioses
(sa future épouse aura une vie de rêve, et lui se lancera
peut-être dans la politique).
Merci Oliver David, tu mérites d’être
élu président de la république. Nous ne risquons pas
de t’oublier !
Il est 16 heures 20 exactement quand nous partons
au volant de notre Nissan. Le monde s’ouvre enfin à nous …
Florence CANARELLI

